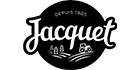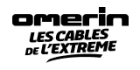Le 11 novembre est une date qui invite au souvenir, à notre passé. Cette Histoire qui permet de comprendre le présent et de mettre des garde-fous sur les horreurs qui ont été commises afin de ne jamais les reproduire. L’enfance de Bernard Goutta est chargée d’un passé que la France a longtemps caché, dissimulé, comme on glisse de la poussière sous un tapis afin de ne pas s’en encombrer : celle des familles HARKI où il a grandi et s’est construit.

Pour comprendre le contexte, il faut faire un saut en arrière, au lendemain de la seconde guerre mondiale, au moment où les gouvernements européens comprirent que les empires coloniaux allaient prendre fin face aux différents mouvements de libération et d’indépendance. En Algérie, où le sol regorge de gaz et de pétrole, la France joua longtemps les prolongations. Pour défendre ses intérêts face aux mouvements indépendantistes menés par le FLN (Front de Libération Nationale), l’état français engagea des troupes « spéciales » particulièrement mobiles et connaissant parfaitement le terrain : les Harkis (« mouvement » en arabe). Pendant de très longues années, ces Algériens (environ 150 000), dirigés par des officiers français, furent les anges-gardiens de cette colonie en déjouant les plans et les actions terroristes du FLN. Cette guerre civile prit officiellement fin lors des accords d’Evian le 18 mars 1962 lorsque la France négocia avec le FLN, libérant l’Algérie de son emprise. Les Harkis furent alors désarmés et livrés au FLN qui procéda à plusieurs dizaines de milliers d’exterminations en représailles. Certains officiers français refusèrent d’être complices de ce massacre et poussèrent l’état à organiser un rapatriement des Harkis « épargnés » sur le sol français.
Une enfance entre barbelés et couvre-feu !
Bernard Goutta fait partie de cette première génération d’enfants de famille Harki nés sur le sol français. La voix chargée d’émotion, l’entraineur clermontois revient sur « cette histoire difficile et douloureuse. » « J’ai toujours été fier de l’histoire de ma famille, de mon père qui s’est battu pour la France en Indochine (où il fut prisonnier de guerre pendant 2 ans) puis sur son sol à devoir combattre son propre pays ». La famille Goutta, originaire de Boghari (où ils ne reviendront jamais), fut épargnée des massacres après la libération du pays « grâce à la bravoure d’un officier qui refusa de livrer sa troupe Harki » et arriva en France en 1962. Hébergée dans des tentes de fortune puis transférée au camp Joffre de Rivesaltes, la famille de Bernard passa 14 années dans les baraquements militaires qui avaient successivement été des lieux d’accueil transitoires pour les Tsiganes, les immigrés ayant fui le régime franquiste en Espagne et les juifs emprisonnés avant de rejoindre les camps de concentration en Allemagne durant la seconde guerre mondiale. Les Harkis en furent les derniers occupants. « Nous étions cachés par la société. Perdus dans la garrigue, loin de tout, dans un camp entouré de barbelés où nous avions interdiction de sortir et où nous devions obéir au couvre-feu. » C’est dans cet environnement que Bernard a grandi dans une famille composée de 9 enfants où le seul salaire de son père (employé à l’Office National des Forêts) devait nourrir les 11 bouches qui la composaient. « Mes frères ont souffert de la faim sur le camp Joffre. Mes souvenirs se limitent à cette terre ocre et l’insalubrité des lieux où les toilettes communes étaient en dehors de notre maison ». Protégé par la bienveillance et l’amour de sa mère, Bernard n’a pas souffert de ces conditions mais n’a pas tardé à se rendre compte de la cruauté de la situation. « Comme tous, j’ai compris que nous étions des parias de la société. Nous étions rejetés par notre pays d’origine et personne ne voulait de notre intégration dans notre pays d’accueil que nos familles avaient pourtant défendu le fusil à la main. Nous ne jouions qu’entre enfants harkis et la scolarisation était très difficile. Nous étions considérés comme des barbares exclus de tout et de tous. Nous vivions la souffrance de nos parents par procuration avec un infini respect pour leur résilience. Ils n’avaient pas le droit de se plaindre et la menace de leur renvoi en Algérie planait au moindre problème. »
« Je devais aller vers les autres, car je savais que les autres ne viendraient jamais vers moi d’eux-mêmes ».
Comprimé dans cet environnement lourd et anxiogène, Bernard trouva son exutoire : le sport. « Je devais aller vers les autres, car je savais que les autres ne viendraient jamais vers moi d’eux-mêmes ». A 6-7 ans, il arriva à convaincre sa mère de payer sa licence au club de foot de Rivesaltes en lui faisant la promesse qu’elle « le verrait un jour à la TV ». Un sacrifice consenti par la famille qui transforma sa vie et lui permit de tenir cette promesse et cela même si le ballon changea de forme. « Je devais faire 2 kilomètres en courant avant chaque entrainement et pareil au retour mais, pour la première fois, j’avais l’impression d’être avec les autres, considéré comme un petit garçon normal, comme tout le monde. Ce fut mon vecteur d’intégration ». Doué et surmotivé à l’idée de fuir un environnement difficile, il multiplie les expériences : foot, basket, handball, rugby à XIII et à XV jusqu’à disputer 3 rencontres en un week-end dans autant de sports différents. « Le sport était mon exutoire et mon moyen de m’intégrer. Je sais aujourd’hui que je lui dois tout. »

A 16 ans, Bernard décide de suivre les pas de son père en s’engageant dans l’armée. Il passera 3 ans au régiment d’Issoire, avant que sa maman ne le rappelle après le décès de son père. « Elle avait peur pour moi, peur que je parte sur un front où elle risquait de me perdre. » « Il faut toujours écouter les mamans » sourit le Catalan qui s’exécuta et intègra quelques temps plus tard le club de Pia (3ème division) où un emploi de chauffeur livreur l’attendait. C’est là que l’USAP le repèrera et en fera l’idole de tout un club (une tribune porte son nom au stade Aimé Giral de Perpignan). Une drôle de revanche pour ce « paria » devenu « icone » de la région. « Je ne le prends pas comme cela », se défend Bernard « je me suis toujours construit à travers l’histoire de mes parents mais pas dans un sentiment de revanche. Personne n’aurait d’ailleurs imaginé que je serai capitaine un jour de l’USAP. Pendant 5 ans, personne au club n’a entendu le son de ma voix. J’étais introverti, timide et un jour tout a changé. Porté par un sentiment de révolte après un conflit avec un entraineur (NDLR : Alain Teixidor en 1999) je suis devenu un autre homme. Toute ma vie, j’avais vu mes parents tout accepter sans jamais rien dire de leur souffrance, même si ce n’était pas comparable, je voulais en finir avec ça. Peut-être qu’à ce moment-là, j’ai évacué la frustration de mon enfance et une partie de celle de mes parents… » Depuis, une nouvelle personnalité s’est affirmée et a porté l’emblématique troisième ligne de l’USAP vers une popularité « qui a rendu fière ma famille et par procuration toute la communauté ». La promesse à sa maman était tenue, mais Bernard plein d’humilité sait bien que son histoire n’est qu’une exception que l’intégration par le sport a favorisée. « Tous les harkis portent en eux des cicatrices béantes et indélébiles. Toutes les familles ont connu l’isolement, l’exclusion et la misère sociale. Tous ont eu besoin d’évacuer la souffrance de leur histoire et en ont payé le prix fort, à travers le mal-être, la dépression, l’alcoolisme ou encore le suicide ». L’un de ses frères n’a pas supporté et a quitté ce monde de drames endurés par les familles Harki depuis leur arrivée sur le sol de notre pays.
Les Harkis restent une tâche de sang sur le drapeau français et même si François Hollande, alors chef d’Etat, reconnaissait en septembre 2016 plus de 50 ans après les faits « la responsabilité des gouvernements français dans l’abandon des harkis, les massacres de ceux restés en Algérie et les conditions d’accueil inhumaines de ceux transférés en France » cela ne suffit pas à gommer l’ineffaçable. « La France a reconnu partiellement la situation sans la moindre réparation morale », constate Bernard. « Tous ceux qui ont souffert de cette situation attendent encore que l’état reconnaisse qu’il n’a pas été à la hauteur de ce que nos parents ont donné pour la France. Pour tous ces Harkis, le plus dur n’a pas été la guerre dans leur propre pays ou leur engagement sur le front de l’Indochine mais l’accueil du pays pour lequel ils ont combattu. Durant très longtemps, cette partie de l’histoire a été cachée, probablement car l’état n’en était pas très fier et espérait que le temps dissipe la vérité. »
Aucun Harki n’a oublié… le devoir de mémoire.
Crédit photo : ©KevinDolmaire EPCC Memorial du Camp de Rivesaltes